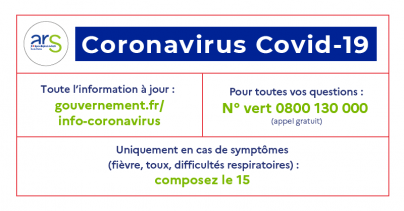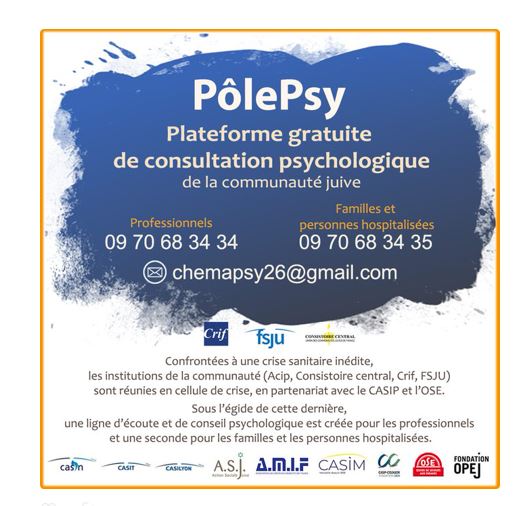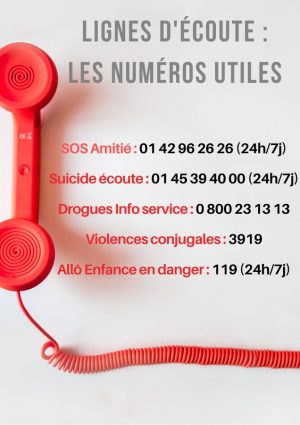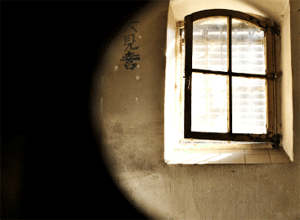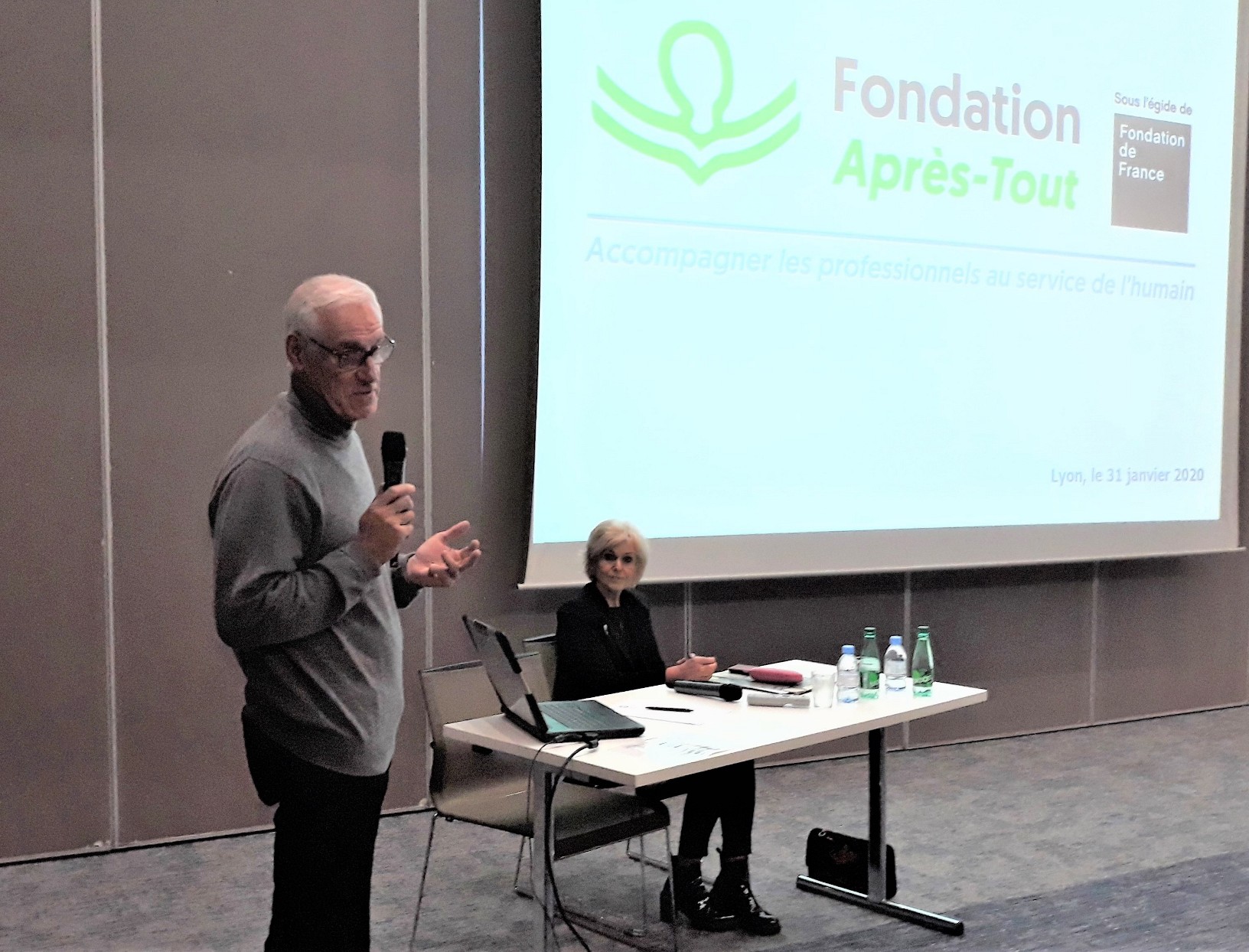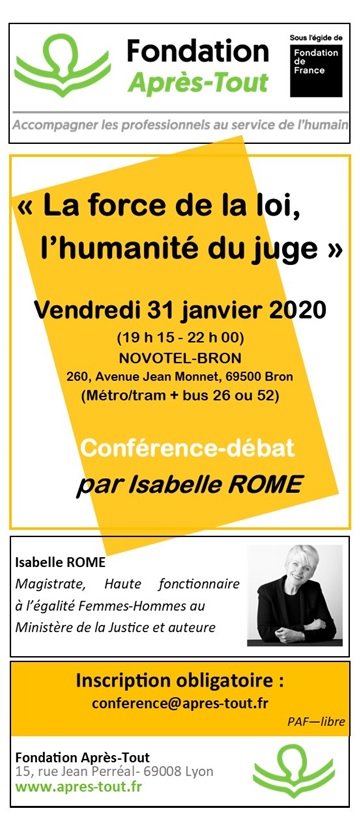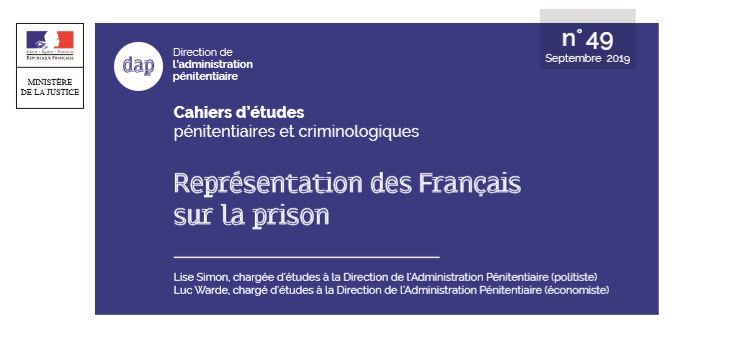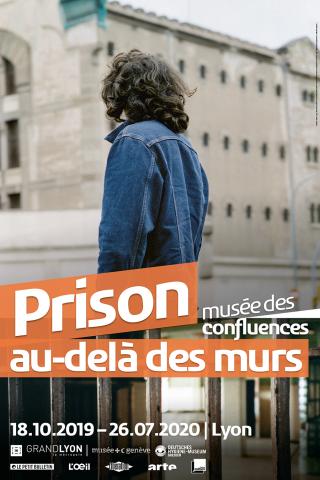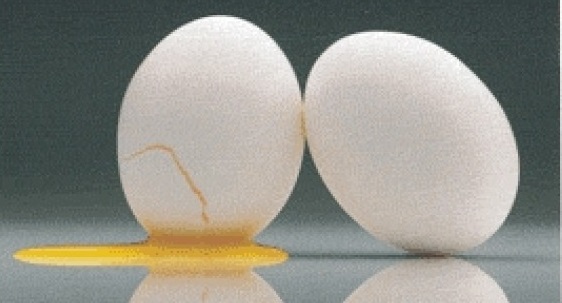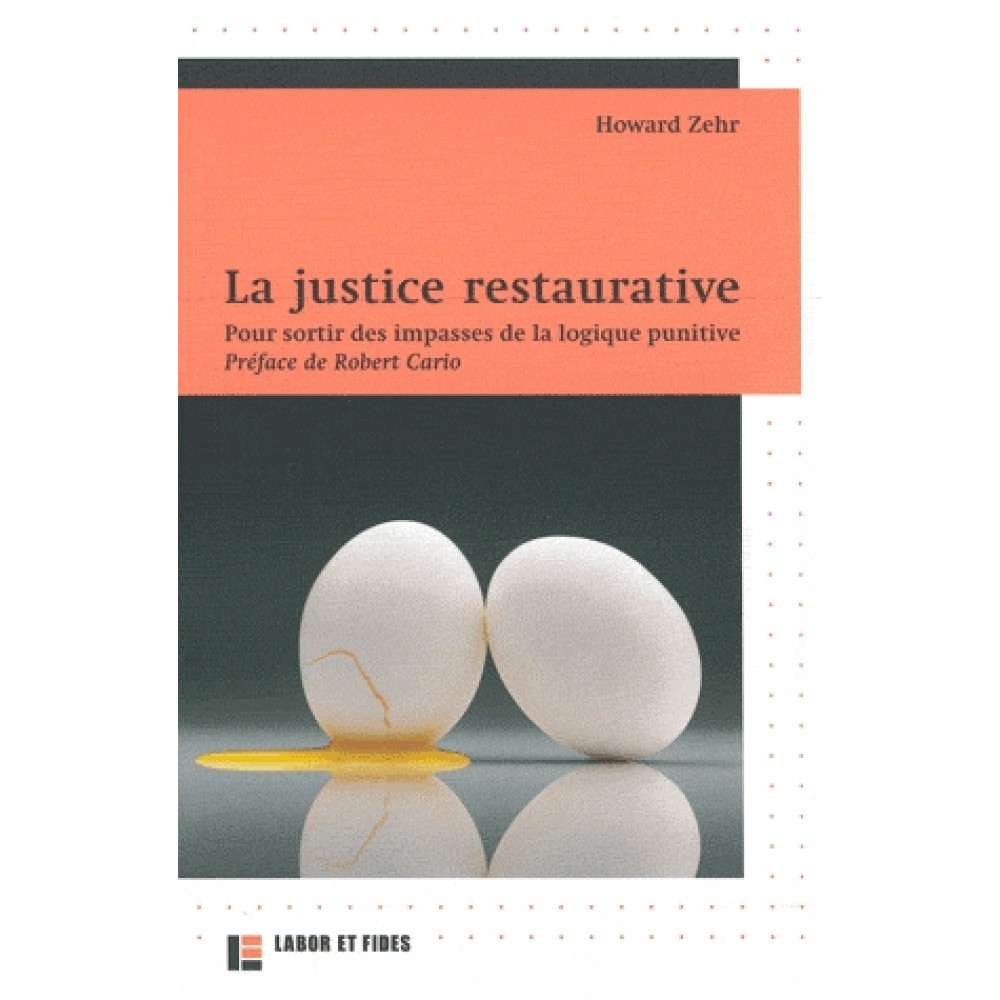Des associations
Ainsi, si l’Education nationale assure des cours à l’intérieur de la prison, des cours sont aussi dispensés par deux associations : AUXILIA et le GENEPI.
AUXILIA donne des cours par correspondance, mais aussi sur place. Une trentaine de personnes bénéficient des cours, en individuel ou en petit groupe ; une soixantaine de personnes bénéficient des cours par correspondance. Les niveaux sont très variés : de l’illettrisme à la préparation d’examens.
Le joli nom de GENEPI a été choisi pour sa symbolique : petite fleur qui pousse en milieu hostile. C’est aussi un sigle : groupement étudiant national d’enseignement pour les personnes incarcérées. Le GENEPI donne des cours de tous niveaux. Il anime des activités socioculturelles : arts plastiques, musique, ciné-débat. Il est investi également dans l’information et la sensibilisation du public, et notamment en collèges et lycées. Le GENEPI mène une réflexion permanente sur le système pénal et judiciaire.
Les besoins culturels sont aussi assurés par l’ASSEMALC (association socio-éducative de la Maison d’Arrêt de Lyon Corbas). Elle anime et co-finance des activités gérées par ses propres bénévoles : ateliers d’informatique, écrivain public, activités de couture, tricot, dessin, contes. Elle co-anime et co-finance des activités gérées par le SPIP : bibliothèques, canal vidéo interne, et aussi des manifestations de musique, théâtre, concerts, expressions corporelles. Elle a organisé le concours de dessins et poésies.
La CROIX ROUGE qui a de vastes champs d’intervention, nationalement et internationalement, a le souci de l’amélioration des conditions de détention, en particulier des plus démunies. Elle participe aux actions de l’association socio-éducative. Elle peut proposer aussi des actions qui lui sont spécifiques, comme une formation aux premiers secours, ou des prises en charge financières ponctuelles
Les personnes détenues peuvent être aussi des parents… Pour certains, leurs enfants viennent les voir dans le cadre du parloir familles, avec l’autre parent. Pour d’autres, la situation est plus délicate : situation de conflit entre les parents, divorce, enfants placés, par exemple. Le REP, relais enfants-parents, accompagne des enfants qui viennent voir leur père ou leur mère incarcérée, pour permettre que cette visite puisse se faire et se faire dans de bonnes conditions pour l’enfant et son parent. Le REP prend l’enfant en charge dans son lieu de vie, l’accompagne à la prison, est présent durant la visite, et réaccompagne l’enfant dans son lieu de vie.
Parmi les personnes détenues, un certain nombre sont de nationalité étrangère. La CIMADE, mouvement de solidarité avec les étrangers, pour la défense de leurs droits, les rencontre. Celles-ci, en effet, ont des problèmes particuliers, en tant qu’étrangers : renouvellement de leur titre de séjour, si elles étaient en situation régulière ; recours éventuels contre des mesures de renvoi : une personne en situation régulière peut faire l’objet d’une mesure de renvoi, en plus de sa peine de prison ; c’est ce qu’on a appelé la double peine.
Sont en prison aussi des personnes « sans papier »…c’est à dire sans titre de séjour, et en général, sans papier non plus de leur pays d’origine. Elles peuvent être en France depuis de nombreuses années, ou venir seulement d’arriver.
Certaines personnes étrangères sont incarcérées, en effet, pour des délits n’ayant trait qu’au droit au séjour : (absence de titre de séjour, cumulée avec une absence de document d’identité, ou bien utilisation de faux passeport, ou faux titre de séjour).
Pour les unes comme pour les autres, il s’agit, au regard de la situation précise de la personne, de l’informer des droits qu’elle a, ou n’a pas, de rester sur le territoire français, et de l’aider dans les démarches juridiques qu’elle souhaite faire ; renouvellement de titre, recours contre des mesures de renvoi, demande d’asile, ou aide au retour dans son pays….
Les personnes détenues le sont pour un temps donné. Des associations se préoccupent plus précisément de leur sortie.
Ainsi, COMPANIO rencontre les personnes détenues dans les deux mois qui précèdent leur sortie, afin de leur proposer un soutien et un accompagnement, dans les efforts qu’elles auront à faire pour trouver ou retrouver une place dans la société. Il s’agit d’un accompagnement individuel, sans limitation de durée, destiné à venir en aide aux personnes quand elles sortent de prison. Dans les difficultés qu’elles rencontrent alors (logement, travail, santé etc.) COMPANIO joue un rôle d’interface entre la personne accompagnée et les divers partenaires susceptibles de se mobiliser.
La FNARS intervient pour la sortie. Elle est une fédération qui regroupe notamment tous les CHRS (centre d’hébergement et de réadaptation sociale) qui ont vocation à aider à la réinsertion des personnes en difficulté sociale. Dès leur origine, les CHRS ont accueilli des sortants de prison. Ils accueillent aussi des personnes en aménagement de peine : PSE (placement sous surveillance électronique) et des personnes en placement extérieur.
Durant le temps de l’incarcération, les personnes détenues ont besoin de relations, d’échanges, pour vivre leur quotidien et préparer l’après prison. L’ANVP, association nationale des visiteurs de prison, contribue à répondre à ce besoin. 45 visiteurs, à Corbas, rencontrent régulièrement, chacun, en moyenne, 2 personnes détenues, à leur demande. Ces rencontres n’ont pas d’autre but, que d’être une rencontre. Une possibilité pour la personne détenue de pourvoir parler, être écoutée, faire des projets, avoir une relation suivie avec quelqu’un du dehors et maintenir ainsi un lien social.
Ce maintien de liens se fait aussi par courrier, avec le SECOURS CATHOLIQUE. Une de ses activités s’intitule en effet « amitié courrier » : une cinquantaine de bénévoles correspond régulièrement avec une centaine de personnes détenues.
Le SECOURS CATHOLIQUE apporte aussi un soutien financier, par le biais de la commission indigence. Ainsi, 80 à 90 personnes détenues, sans ressources, reçoivent 25 euros par mois. Cela leur permet d’avoir un minimum pour cantiner, des produits d’hygiène, ou alimentaires ou vestimentaires, sans subir les pressions d’autres personnes détenues.
Sont aussi membres du GLCP, les aumôneries qui assurent un rôle important, non seulement au niveau de la pratique religieuse, mais aussi dans le besoin de relations des personnes détenues.
Les aumôneries
Les Aumôneries : quatre aumôneries interviennent à Corbas, catholique, protestante, musulmane et israélite, sachant que pour cette dernière il y a un rabbin référent, qui vient au parloir avocat sur rendez-vous. L’aumônerie musulmane est assurée régulièrement chez les femmes par une aumônière. Un imam vient chez les hommes, mais pour le moment, il y a un déficit de présence par rapport aux besoins. Pour les aumôneries catholique et protestante, ce sont des équipes : prêtres, pasteurs, laïcs hommes et femmes (entre 15 et 20 personnes). Ces équipes assurent le culte, des rencontres bibliques, du chant choral, pour les chrétiens. Elles animent en commun des groupes de parole, ouverts à toutes les personnes détenues.
Les aumôniers ont aussi la particularité d’avoir accès aux personnes détenues dans leurs cellules. Ils assurent ainsi un grand nombre de visites en cellules ; à tous ceux qui le souhaitent, quelle que soit leur religion, ou sans religion. Ces visites peuvent durer de quelques minutes à plus d’1 heure. Ils sont là pour écouter, réconforter, créer du lien. La visite en cellule, c’est aussi un temps où la personne détenue peut « recevoir ». Grâce à ce qu’elle a cantiné, elle peut offrir à l’aumônier café, gâteaux.
Les aumôniers ont le souci d’être facilitateur de parole, de dialogue, entre les diverses personnes intervenant dans la prison.
Des représentants de plusieurs associations participent à des instances au sein de l’Administration pénitentiaire aux commissions « indigence » et « prévention suicide ».
Des actions communes sont menées par plusieurs associations, par exemple les confection, financement et distribution des colis de Noël.
L’accueil des familles
A l’origine, l’ACCUEIL SAN MARCO s’est créé pour répondre à un besoin bien précis : celui d’offrir un lieu abrité pour les familles qui stationnaient, par tous les temps, devant la porte de la prison en attendant l’heure du parloir. Un lieu où l’on trouvait des toilettes, la possibilité de prendre un café, de se poser un moment, à l’abri des intempéries. Un local avait été trouvé, juste en face des prisons Saint Paul-Saint Joseph. Depuis le déménagement à Corbas, l’ACCUEIL SAN MARCO est hébergé dans un local de l’Administration pénitentiaire. C’est un progrès, car c’est une reconnaissance par l’administration de la nécessité d’un tel lieu. Mais c’est un peu moins simple, car se retrouvent dans un même local, l’Accueil San Marco, les surveillants qui font l’appel des familles, un gestionnaire privé qui a en charge, les casiers, les bornes de prises de rendez-vous et la garde des enfants de plus de 3 ans, quand ils ne vont pas au parloir.
La 1ère démarche pour les familles est de faire une demande de permis de visite. Il faut constituer un dossier. L’ACCUEIL SAN MARCO assure donc l’information et l’aide à la constitution de ces dossiers et, quand le dossier est complet, le remet à l’administration. Les personnes ont la réponse par courrier, dans les 8-10 jours suivants, lorsqu’il s’agit de la famille proche et quand tout fonctionne normalement.
Ce lieu est aujourd’hui, un passage obligé : les familles déposent dans ce local les sacs et divers objets qui ne peuvent rentrer au parloir ; c’est là que se fait l’appel par le surveillant qui les fait entrer ensuite dans la prison. C’est là que se font les réservations pour les parloirs suivants.
Ce lieu, passage obligé, est aussi un lieu d’écoute et de partage. Le parloir est un moment capital, et pour la famille et pour la personne détenue, moment à la fois très attendu et redouté. L’angoisse est grande avant le premier parloir : c’est important de pouvoir en parler.
Tout cela peut se dire…se dit….dans des échanges individuels… L’équipe de l’ACCUEIL SAN MARCO est dans une écoute respectueuse, neutre et confidentielle ; tout peut se dire…se dit… entre les familles elles-mêmes. Elles sont toutes dans la même galère et ne se jugent pas. Elles échangent sur leurs vécus, leurs ressentis, leurs problèmes. Ce lieu d’accueil est ainsi lieu de partage.
Travailler en complémentarité
Les associations ont un conventionnement avec le SPIP ou l’Administration pénitentiaire, nationalement ou localement ; conventionnement qui régit leurs modalités d’intervention, et leurs obligations. Une fois ce cadre posé, elles gardent leur indépendance et leur autonomie d’action. Elles s’inscrivent toutes dans une démarche éthique et universelle fondée sur les droits de l’Homme. Elles travaillent avec les différentes instances de l’Administration et le SPIP en particulier. Elles sont aussi amenées à interpeller les autorités concernées si elles sont témoins de dysfonctionnement.
Dans chaque association, les intervenants bénéficient de formation, de soutien, de temps d’échange et de réflexion, sur leurs pratiques.
Beaucoup de monde franchit tous les jours les portes de la prison. Ce franchissement est important, comme lien entre le dedans et le dehors. Si la personne détenue subit une peine privative de liberté, c’est-à-dire la privant de la liberté d’aller et venir, il est important qu’elle ne soit pas privée de tout ce qui permet une vie humaine et digne. Cela pour 2 raisons essentielles :
1ère raison : Quelle que soit la gravité de l’acte commis, une personne n’est jamais réductible à ses actes. Elle doit être respectée et traitée avec dignité.
2ème raison : Si la société veut éviter la récidive, il est important de se comporter avec la personne détenue, comme on attend qu’elle se comporte envers les autres.
Dit autrement, comment demander à quelqu’un de se comporter en citoyen respectueux de la loi et de ses semblables, si soi-même, si l’institution ne respecte pas ses droits, n’est pas respectueuse à son égard ? Dans nos pratiques, nous sommes attentifs à tout ce qui peut mettre du lien humain, entre les partenaires, les surveillants, tous les divers intervenants. Nous pensons important la formation, à ce niveau, de tous, bénévoles ou professionnels.
Nous sommes attachés à tout ce qui peut permettre l’humanisation des prisons, à ce qui permet plus de respect de la dignité des personnes. Les conditions matérielles et d’organisation sont en cela très importantes. Mais les conditions de liens humains le sont grandement aussi.
Le monde de la prison, bien que les nouvelles prisons soient construites loin de lieux habités, ne doit pas rester étranger à la société. Tout ce qui favorise la communication à l’intérieur, mais aussi entre l’intérieur et l’extérieur, est important. Pouvoir parler, s’exprimer, dialoguer, communiquer, individuellement, et collectivement est essentiel.
Julienne Jarry, coordinatrice du GLCP, 24 novembre 2010
PS : à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, intervient également le CLIP qui donne des cours d’informatique et a, en permanence, une trentaine de détenus stagiaires. Ces stages durent environ 6 semaines, à raison de 12 heures/semaine et ensuite une trentaine de nouveaux stagiaires.