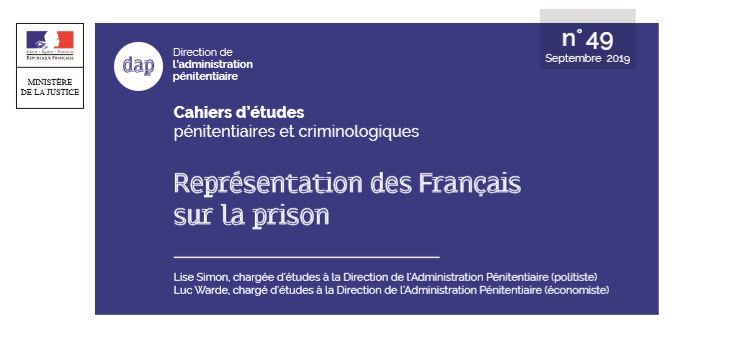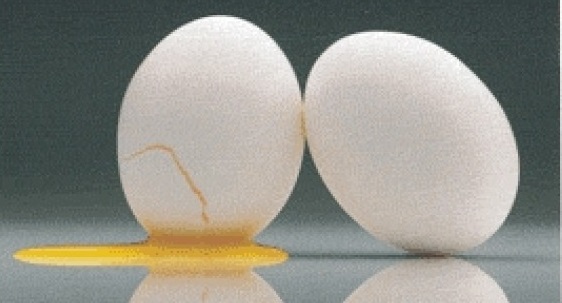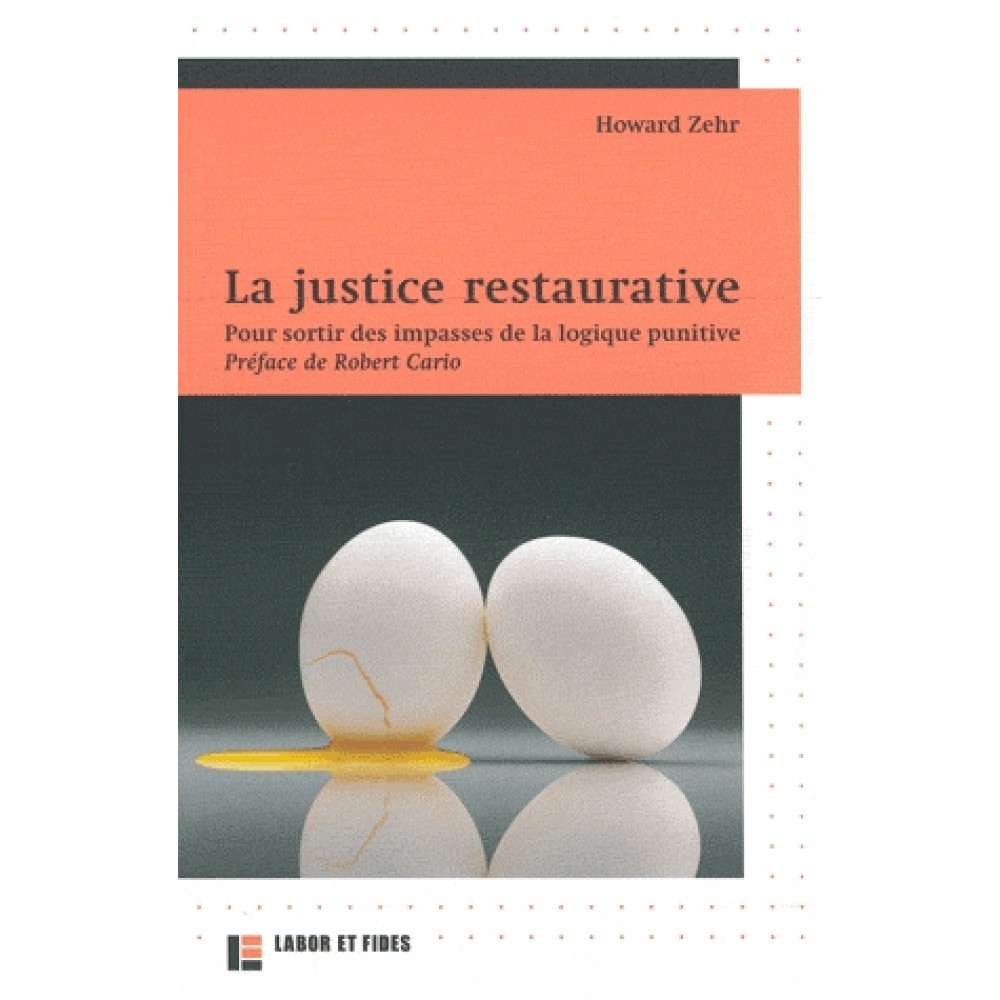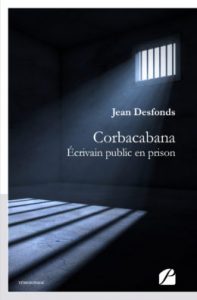Note rédigée par Alain Chalochet
Deux mesures d’importance sont intervenues au cours des derniers mois : la création d’une Agence du travail d’intérêt général d’une part, et d’autre part, l’adaptation de la loi en vue d’étendre les possibilités du prononcé de la peine de travail d’intérêt général.
La création d’une agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice
Cette agence a été créée par le décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 visant au développement du travail d’intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle pour les personnes placées sous main de justice ; cette décision est en adéquation avec l’objectif d’augmentation du nombre de bénéficiaires d’un travail d’intérêt général fixé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L’agence est chargée :
+ d’assurer la promotion du travail d’intérêt général (TIG) et de l’emploi pénitentiaire, d’établir des statistiques et d’évaluer la mise œuvre de ces dispositifs
+ de rechercher des structures susceptibles d’accueillir des postes de TIG ainsi que des types d’activités pour ces postes
+ de rechercher des partenaires pour développer le travail et faciliter l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice
+ d’animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire
+ de proposer au ministre de la Justice des évolutions pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des offres d’activité par les structures partenaires
+ de proposer au ministre de la Justice, en lien avec les autres ministères concernés, une stratégie nationale du TIG, de l’emploi pénitentiaire et de l’insertion professionnelle et par l’activité économique.
S’agissant du TIG, l’agence est chargée d’administrer une plate-forme numérique permettant notamment de recenser les offres de postes de TIG, rechercher des partenaires et faciliter le suivi des personnes qui accomplissent cette peine. Cet outil est partagé entre la direction de l’administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et les services judiciaires.
Pour le travail pénitentiaire, l’agence doit, en complément du travail en concession et du service général, assurer la gestion en régie de l’emploi dans les établissements pénitentiaires et organiser la commercialisation des biens et services produits par les détenus.
L’Agence est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du ministre de la Justice, rattaché pour sa gestion à la direction de l’administration pénitentiaire.
A sa tête, est placé un directeur, pouvant être assisté d’un adjoint, nommés par le Garde des Sceaux. L’agence s’appuie, pour définir et mettre en œuvre ses actions, sur un comité d’orientation stratégique – composé de 20 membres, représentants de l’État (dont le directeur de l’administration pénitentiaire, directrice de la PJJ et délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle), représentants des collectivités publiques et représentants d’entreprises, d’associations, de structures de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, l’agence reprend les compétences du service de l’emploi pénitentiaire (SEP), basé à Tulle. Ce SEP, qui gère 47 ateliers dans 26 établissements pénitentiaires et administre le compte de commerce, devient un service de l’agence.
L’agence est structurée autour d’entités qui reprennent les missions qui lui sont confiées :
+ développement de l’offre de postes de TIG, avec animation d’un réseau de délégués territoriaux, développement des partenariats, gestion d’une plateforme numérique
+ développement des activités professionnelles, particulièrement du travail pénitentiaire, de l’insertion par l’activité économique, des entreprises adaptées, de la formation professionnelle et de l’apprentissage
+ création de services supports, détachés de l’ancien SEP, répondant aux besoins de l’ensemble de l’agence.
Concernant le développement du TIG, l’agence sera représentée sur les territoires par un réseau de 61 délégués territoriaux. Exerçant à temps plein, ils assureront une mission de recherche et de diversification des postes de TIG sur leur territoire de compétence. Ils travailleront en lien étroit avec les équipes des Services pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP), les services de la PJJ et l’autorité judiciaire.
Au-delà des contacts réguliers déjà entretenus avec le secteur associatif et avec les collectivités territoriales pour inciter à créer des postes de TIG, la principale innovation consiste à désigner dans les territoires des délégués territoriaux à temps plein, qui se consacreront exclusivement à cette activité pour promouvoir et diversifier l’offre de TIG.
A la direction de la PJJ, des correspondants TIG seront nommés au sein des directions territoriales pour assurer le lien avec les SPIP sur les postes TIG habilités mineurs. Ils assureront, pour partie de leur temps, des missions de prospection et de renseignement des postes habilités mineurs sur la plateforme TIG. La mission d’insertion sociale et professionnelle, commune aux mineurs condamnés et à ceux faisant l’objet d’une mesure éducative, reste sous l’entière responsabilité des services de la PJJ.
L’agence est dotée d’un outil numérique dédié au développement de la mesure de travail d’intérêt général.
Cette plateforme numérique doit permettre de :
+ faciliter le prononcé de la peine d’intérêt général avec une visualisation des postes de TIG dans le cadre de l’audience, de la mise en œuvre de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou de la composition pénale, et du suivi post-sentenciel des personnes placées sous main de justice
+ faciliter la prospection de structures d’accueil par un outil de pilotage des actions de prospection, et la dématérialisation des procédures d’habilitation et d’inscription des postes
+ faciliter la gestion des TIG, avec l’affectation d’une personne majeure ou mineure sur un poste de TIG, la vision prévisionnelle de l’occupation des postes, la pré-réservation des postes, le suivi horaire de l’exécution et de la fin d’une mesure de TIG.
A terme, les utilisateurs pouvant accéder à cette plateforme seront multiples : les acteurs internes au ministère de la Justice, les avocats, les structures d’accueil et leurs tuteurs, les tigistes et le grand public, par un accès Internet, afin de renseigner les structures d’accueil potentielles.
Le développement et l’expérimentation d’un prototype ont été lancés avec quatre TGI pilotes : Dijon, Mâcon, Lille et Béthune, pour les majeurs comme pour les mineurs.
Le projet de construction d’une plateforme numérique pérenne, qui intègrera la transmission de données avec un logiciel « Application des Peines – Probation – Insertion » (APPI) qui devrait aboutir d’ici 2020.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu d’étendre les possibilités de prononcé de la peine de TIG, et lui donner une place plus forte dans le dispositif de répression.
Définition : le TIG est une peine prononcée par une juridiction pénale qui consiste en l’exercice d’un travail non rémunéré au sein d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, d’une collectivité ou d’une association habilitée.
Comment peut-il être prononcé ?
Il peut l’être sous plusieurs formes : •
+ Le TIG : peine alternative à l’emprisonnement avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général •
+ Sursis assorti de l’obligation d’effectuer un TIG (STIG) : peine d’emprisonnement assortie d’un sursis comportant l’obligation d’accomplir un TIG. Le STIG peut également résulter d’une conversion d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à 6 mois par le juge de l’application des peines (JAP). Le TIG peut être prononcé contre des personnes ayant commis un délit ou une contravention de cinquième classe.
Les conditions tenant à la personne
+ le TIG peut être prononcé à l’égard de tous les mineurs d’au moins seize ans au jour du jugement, s’ils étaient âgés d’au moins treize ans lors de l’infraction.
Les conditions tenant au passé pénal de la personne
+ le TIG peut être prononcé quelles que soient les condamnations antérieures
+ le STIG ne peut être prononcé à l’encontre d’une personne en état de récidive ayant déjà été condamnée à deux sursis avec mise à l’épreuve (SME) (ou 1 SME et 1 STIG, ou 2 STIG) pour des faits assimilés, ou ayant été condamnée à un SME si la nouvelle infraction est un crime, un délit de violences volontaires, d’agression ou d’atteinte sexuelle ou un délit aggravé par des violences.
Dans l’esprit de la loi, cette peine de TIG a vocation à être plus largement prononcée, sans se limiter aux primo délinquants ou aux personnes présentant des difficultés d’insertion, ou encore à certaines typologies de faits délictueux. En effet, cette peine s’avère pertinente pour la personne condamnée comme pour la société, en ce qu’elle permet de maintenir l’insertion, facteur essentiel de prévention de la récidive.
Pour les mineurs, le TIG ne se substitue pas à une mesure éducative dont le prononcé demeure prioritaire en application de l’ordonnance du 02-02-1945 relative à l’enfance délinquante.
Les conditions tenant au consentement de la personne
+ Si le prévenu est présent à l’audience, la peine de TIG ne peut être prononcée s’il la refuse.
+ S’il n’est pas présent à l’audience mais représenté par son avocat, cette peine ne peut être prononcée que s’il a fait connaître par écrit son accord.
+ S’il n’est ni présent, ni représenté, et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée qu’en cas d’application du 2ème alinéa de l’article 131-9 (prononcé de la durée maximum de l’emprisonnement ou du montant maximum de l’amende si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la peine prononcée). Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de TIG, le JAP informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail.
Le condamné étant libre de refuser, et tout travail forcé étant prohibé, le JAP doit apprécier les « possibilités d’aménagement ou de conversion » en application de l’article 131-8 du Code Pénal.
En revanche, quand le condamné a exprimé son consentement au TIG, il ne peut ensuite s’opposer à la mise en œuvre de la mesure sans encourir la mise à exécution de la peine fixée par la juridiction en cas de violation des obligations résultant de la peine prononcée.
La fixation de la peine encourue en cas de violation des obligations ou interdictions du TIG peut également être privilégiée quand le prévenu est présent à l’audience, permettant ainsi de l’informer des conséquences potentielles d’un non-respect, d’assurer l’efficacité de la réponse judiciaire en cas d’inexécution, et d’éviter d’avoir à diligenter de nouvelles poursuites sur ce fondement.
Dès lors, lorsque les faits soumis au tribunal ainsi que les éléments de personnalité recueillis préalablement au jugement paraîtront justifier une peine de TIG malgré l’absence de comparution du prévenu, seront privilégiées les réquisitions tendant au prononcé d’une telle mesure par rapport à celles concluant à un emprisonnement ferme, spécialement pour les jugements contradictoires à signifier, source de courtes peines d’emprisonnement.
Les conditions liées à la motivation de la peine
Selon le nouvel article 485-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), la peine doit être motivée quant aux circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur.
Le contenu
+Modification de la durée de la peine : de 20 à 120 heures pour une contravention et de 20 à 400 heures pour un délit
Cette augmentation vise à réduire le décalage qui existe aujourd’hui entre la durée relativement faible de la peine de TIG et la lourdeur de la peine d’emprisonnement encourue pour un délit et d’améliorer ainsi son caractère réparateur au regard de l’infraction commise, de permettre son prononcé pour des faits justifiant une répression plus sévère et renforcer son caractère d’alternative réelle et crédible à une peine d’emprisonnement.
S’agissant des condamnés mineurs, l’excuse de minorité n’est pas applicable (article 20-2 de l’ordonnance de 1945) mais les « travaux doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser leur insertion ».
Cependant, cette modification n’a pas pour objectif d’aggraver les peines prononcées à l’égard des mineurs. Le nombre d’heures doit être déterminé en tenant compte du degré de maturité du mineur et de sa capacité à s’inscrire dans un environnement professionnel.
+ La structure d’accueil : personne morale de droit public, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou association habilitée.
+ Le condamné est soumis à des mesures de contrôle et en cas de STIG, peut également être soumis à des obligations particulières déterminées par la juridiction de jugement ou par le JAP.
Tout ceci est en corrélation avec la création de l’agence du TIG qui permettra d’enrichir l’offre de TIG et par conséquent le contenu et la diversité des postes disponibles. L’objectif est ainsi d’inciter les juridictions à prononcer des TIG d’une durée de plus de 280 heures là où étaient auparavant prononcées des peines d’emprisonnement. Ainsi, le TIG pourra concerner, grâce au quantum d’heures plus important et à une offre de postes plus conséquente et diversifiée, les personnes ayant commis des faits justifiant une répression accrue, ne s’étant pas présentées à l’audience ou ayant des antécédents judiciaires.
Afin d’assurer la bonne exécution des mesures, une concertation entre l’autorité judiciaire et le SPIP est préconisée pour vérifier la capacité d’absorption par les structures d’accueil.
Le déroulement
Le condamné est suivi par le JAP et le SPIP pendant la durée de la mesure. S’il est mineur, il est suivi par le juge des enfants et par le service territorial éducatif de milieu ouvert. Le condamné est soumis aux prescriptions règlementaires relatives à l’hygiène, au travail de nuit, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le TIG peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
Le délai d’exécution de la mesure
Le délai maximum d’exécution est de 18 mois. La juridiction qui le prononce peut l’assortir de l’exécution provisoire.
Les causes de suspension du délai sont limitativement prévues par la loi :
+ suspension facultative, sur décision du JAP : motif grave médical, professionnel ou social
+ suspension automatique : assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) (automatique), détention provisoire, exécution d’une peine privative de liberté, accomplissement des obligations du service national
Le TIG peut s’exécuter en même temps qu’une ARSE, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique.
La fin de la mesure
En l’absence d’incident, TIG et STIG prennent fin une fois le travail exécuté, sauf si des obligations complémentaires ont été prévues dans le cadre du STIG, la mesure s’achevant alors à l’issue du délai d’épreuve fixé par la juridiction. Le JAP peut néanmoins mettre fin de manière anticipée au STIG, si le travail a été exécuté.
En cas d’incident dans le cadre du TIG (inexécution du travail dans le délai fixé) : le probationnaire peut être poursuivi ou, si la juridiction de jugement l’a prévu, sanctionné par le JAP, avec mise à exécution de la peine fixée par la juridiction de jugement.
En cas d’incident dans le cadre du STIG (inexécution du travail, non-respect des obligations ou nouvelle condamnation) : le JAP peut révoquer totalement ou partiellement la mesure et au besoin, incarcérer le probationnaire immédiatement. Cette révocation peut également être prononcée par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation.
Source : Ministère de la Justice (justice.gouv.fr)